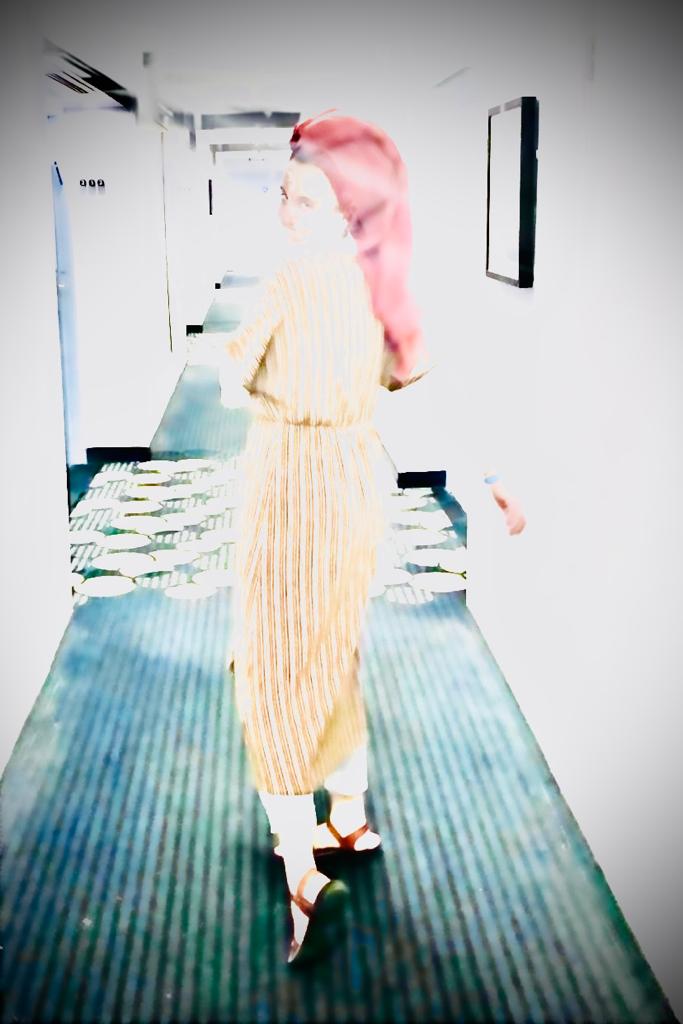Chapitre 54
Les quatre voix et la mer
Ya waldi (mon fils), viens, assieds-toi. Buen shabat (bon sabbat) à tous, dit la tante en posant le pain chaud. Dans un coin, le grand-père lance : Ur tssin ara (tu ne sais pas, en berbère), et tout le monde rit. Puis la porte s’ouvre : un marin de Mogador entre et salue. Good morning, amigo, shalom aleikhem (bonjour, ami, paix sur vous – anglais, espagnol, hébreu).
À Fès ou Marrakech, le judéo-arabe glissait comme un miel épicé : Baraka (bénédiction), shukran (merci), mazal tov (félicitations). On y plantait l’hébreu dans l’arabe comme on plante un grenadier dans un patio. Les phrases sentaient la cannelle, le cuir et la poussière des ruelles.
La haketia se parlait comme une chanson d’Andalousie : Komo estás, prima mía (comment vas-tu, ma cousine), mazal bueno (bonne chance), ke Dios te guarde (que Dieu te protège). On y parlait vite, en riant, avec cette ironie tendre qui ne s’expliquait pas, mais qui se vivait.
Dans l’Atlas, le judéo-berbère liait les vallées : Ur illa aghrum (il n’y a pas de pain), disait-on en souriant, comme une invitation à partager le peu. Langue dure, caillouteuse et pourtant hospitalière, elle portait les alliances, les marchés, les fêtes partagées.
Et à Mogador, le parler mogadorien était une langue de quai et de salon. Comptoir anglais oblige, les Juifs allaient à l’English School, lisaient Shakespeare, écrivaient aux négociants de Londres… mais au souk, au café, à la maison, les phrases se tissaient comme des tapis bariolés. On y disait Seat down, narobess (assieds-toi, ne t’inquiète pas), nehbibessek, darling diali (je t’aime, mon chéri), ou encore Once upon a time it was… flene o’flene (il était une fois des gens ) … L’anglais des affaires, l’arabe quotidien, l’hébreu des prières et le français s’enchaînaient dans la même respiration. Ce n’était pas un mélange hasardeux : c’était un langage entier, celui d’une ville qui parlait quatre langues sans jamais en perdre une seule.
Dire ya latif (ô doux), buen shabbat, ur illa, darling diali, ce n’était pas seulement parler,c’était tisser un monde.
Aujourd’hui, Elles survivent dans un piyout (chant liturgique), un proverbe que personne n’ose traduire, une recette où l’on dit encore kamoun (cumin) plutôt que cumin. Elles palpitent faiblement, comme une lampe à huile qui attend qu’on la rallume.
Si elles disparaissent, il ne restera qu’un silence poli là où vibrait une musique. Alors, ya benti (ma fille), hijo mío (mon fils), aghjun inu (mon enfant, en berbère), gardez-les dans votre bouche, même maladroitement. Car une langue sauvée, c’est un port entier qui reste ouvert à la mémoire. Et c’est doux comme une mélodie qui caresse l’oreille.
Slil