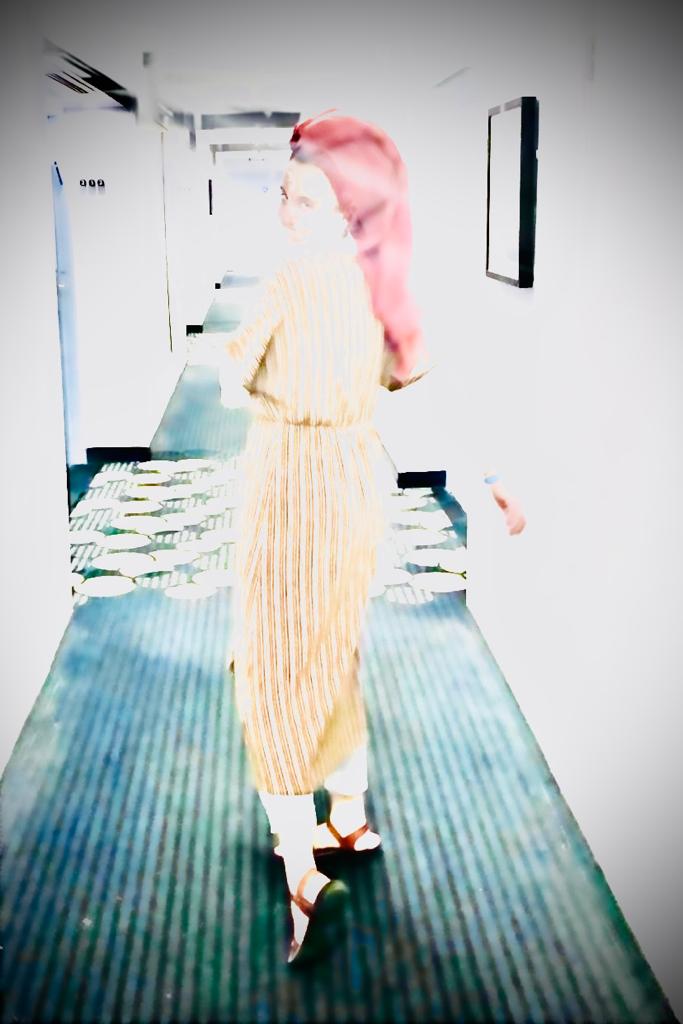Chapitre XLXV
Une mémoire qui s’efface
Nous avons grandi au cœur d’un melting-pot discret, presque sacré, où les langues, les couleurs, les traditions se mêlaient sans jamais s’entrechoquer. Toutes les nationalités, toutes les religions coexistaient dans une paix tacite. Nous étions jeunes, mais déjà, nous apprenions les uns des autres. Chaque regard, chaque repas, chaque mot étaient une leçon d’ouverture, une invitation à comprendre un autre monde.
A cet enseignement naturel s’ajoutaient les langues juives du Maroc dans lesquelles nous avions baigné.
Elles furent le murmure des mères, le rire des marchés, la voix des prières. Elles ont porté les berceuses, les bénédictions et les confidences : le judéo-arabe, le haketia, le judéo-berbère. Ces langues, nées du brassage millénaire entre l’hébreu, l’arabe, l’espagnol et le berbère, sont hélas aujourd’hui à l’agonie. Elles meurent dans un silence triste, étouffées par l’uniformisation linguistique et l’exil.
Elles furent l’odeur du parfum de la menthe et du coriandre, elles furent le miel de nos enfances, la cadence des marchés, le sel des disputes de voisinage. Le judéo-arabe, le haketia, le judéo-berbère : trois voix, trois racines, une même mémoire.
Dans les ruelles des villes, le judéo-arabe roulait sur les pavés comme un fleuve tranquille, parsemé d’îlots hébraïques. C’était l’arabe du pays, mais orné de bijoux secrets, avec des tournures que seuls les enfants du mellah comprenaient. Un mot, un clin d’œil, et tout un monde se reconnaissait.
Au Nord, le haketia avait gardé dans ses plis le soleil d’Andalousie. C’était un castillan ancien, parfumé d’arabe, relevé d’hébreu. Les mots y avaient l’accent des ports et des patios, la nostalgie d’un royaume perdu et la vivacité de ceux qui savent survivre en riant.
Plus haut, dans l’Atlas, le judéo-berbère liait les communautés juives aux tribus amazighes. Langue de montagne, rude et tendre, elle passait de bouche en bouche comme du pain chaud, en reliant les vallées par ses sonorités chantantes.
Ces langues n’étaient pas seulement des moyens de parler. Elles étaient des maisons entières, avec leurs porte grinçantes, leurs cuisines qui embaument, leurs proverbes. Elles contenaient les saisons, les chants, les secrets, les amours et les colères.
Aujourd’hui, elles survivent dans des éclats : un air de mariage chanté à mi-voix, une formule que personne ne traduit plus mais qui évoque mille scènes, une recette qu’on répète en écorchant les mots. Le français, l’hébreu moderne, l’arabe standard et l’espagnol d’aujourd’hui ont recouvert ces musiques anciennes comme on repeint un mur sans voir le motif dessous.
Si elles s’en vont, ce n’est pas seulement un lexique qui s’éteint : c’est un rythme intérieur, une manière d’être ensemble. Les langues juives du Maroc ne demandent pas à revenir dominer les rues. Elles demandent seulement à ne pas être réduites en poussière d’archives. Car une langue oubliée, c’est une pièce scellée de notre maison. Et sans cette pièce, la maison n’est plus tout à fait la nôtre.
Slil