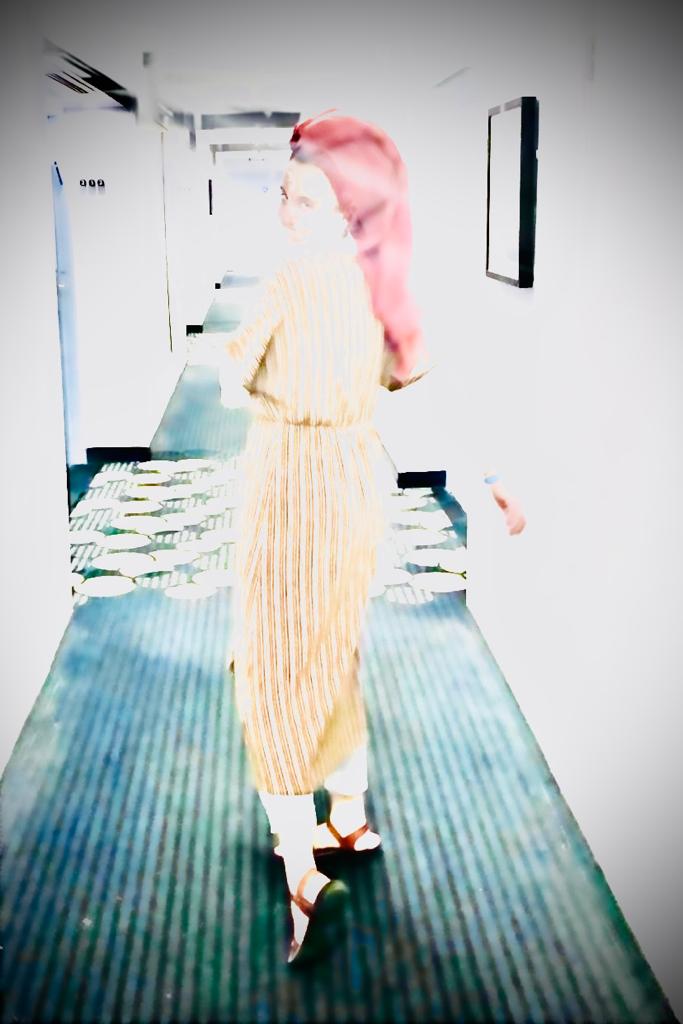Chapitre XLXIV
Ils se marièrent et …
Leur villa rayonnait de vie. C’était un lieu ouvert, généreux, où les enfants du quartier entraient et sortaient sans formalités, sans rendez-vous organisés entre mamans, comme cela se fait dans le monde rigide et coincé d’aujourd’hui, où chaque rencontre, chaque visite, chaque moment doit être planifié, programmé, chronométré. Il suffisait de toquer à la porte sans s’annoncer pour être spontanément le bienvenu. La guerre récente, la misère, les manques, leur avaient appris à ne plus se poser de questions à briser les frontières ou les barrières invisibles à franchir. Juste une porte s’ouvrait sur un monde d’innocence, d’amitié, et de liberté. Les parents ne cherchaient pas désespérément un espace pour que leur enfant puisse respirer un peu de liberté. C’était une époque où l’on savait laisser les enfants être eux-mêmes, sans les enfermer dans des cases ou des emplois du temps.
Le grand garage donnant sur le jardin s’était transformé peu à peu en terrain de jeux, en discothèque improvisée, en salle de boum. On y écoutait la musique à fond sans troubler l’ordre sacré de la maison. Rose râlait parfois, mais au fond, elle adorait ces instants. Elle chantait avec les enfants, sautait à la corde en mode vinaigre, montrait aux filles comment marcher droit avec des livres posés sur la tête. Elle incarnait une figure maternelle joyeuse, espiègle, profondément aimante.
Ce sont surtout les filles qui invitaient les copines. Les garçons étaient plus discrets. Luc, à peine un ado, toujours dans ses pensées, regardait ses sœurs et leurs copines avec tendresse, jouer à la marchande dans la véranda transformée en boutique, ou s’échanger frénétiquement des vêtements au grand dam de leurs mères. Il les observait avec une affection protectrice, une bienveillance de grand frère qu’elles lui rendaient au centuple.
La place Ollier, toute proche, était le théâtre vivant de cette enfance insouciante. Chaque jour, après l’école, une cinquantaine, peut-être une centaine d’enfants s’y retrouvaient. Ce lieu était devenu un carrefour animé, une véritable agora enfantine. Les enfants des quartiers avoisinants s’y joignaient, à l’exception des Maarifiens, que l’on disait “haïcks”, pas assez élégants, pas dans le ton. C’était une exclusion injuste, nourrie davantage par la rumeur publique que par les parents eux-mêmes.
Sur cette place, les enfants découvraient la vie, les jeux, les amitiés, les querelles. Ils grandissaient en jouant aux gendarmes et aux voleurs, en faisant des concours de hula-hoop, en se chamaillant, en se blessant parfois. Ils rentraient alors chez eux en pleurant, dénonçant celui ou celle qui avait été l’instigateur d’un complot contre eux.
Ils formaient une micro-société, une petite république joyeuse où régnaient le rire, les disputes de bac à sable et les serments d’amitié éternelle. Une société éphémère mais lumineuse, dont les souvenirs continuent d’habiter leurs mémoires d’adultes, comme des traces indélébiles de bonheur.
Slil