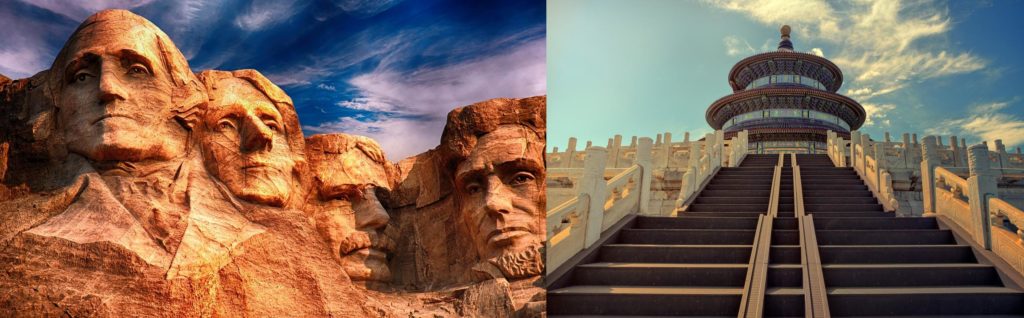Une énergie abondante et peu chère est une condition nécessaire au développement économique. L’Allemagne l’a appris à ses dépens avec des fermetures d’usines consécutivement à l’explosion des prix de l’énergie, mettant ainsi en danger son industrie.
Fermer les centrales nucléaires a été l’une des pires erreurs de Merkel qui se paie cash maintenant.
L’Europe traverse une période charnière dans sa quête d’indépendance énergétique. Privée du gaz russe depuis la guerre en Ukraine et la fin des livraisons par gazoduc via l’Ukraine depuis le 1er janvier 2025, l’Union européenne s’est tournée massivement vers le gaz naturel liquéfié importé, principalement des États-Unis, mais aussi du Qatar, du Nigeria et d’autres fournisseurs. Cependant, cette dépendance croissante envers des sources lointaines pose des questions de coût, de sécurité et de durabilité. Dans ce contexte, les champs gaziers de la Méditerranée orientale, actuels et potentiels, émergent comme une option stratégique. Mais peuvent-ils réellement alléger le fardeau énergétique européen ? Et si oui, à quel volume, depuis quels gisements, et par quels moyens ?
La Méditerranée orientale : un nouvel espoir énergétique ?
Depuis les découvertes majeures des années 2000, la Méditerranée orientale est souvent qualifiée « d’eldorado gazier ». Des gisements significatifs ont été identifiés au large de l’Égypte, d’Israël, de Chypre, et potentiellement du Liban et de la Syrie. Ces ressources pourraient diversifier les approvisionnements européens, réduisant ainsi la dépendance envers les importations transatlantiques ou asiatiques. Cependant, leur exploitation et leur exportation vers l’Europe dépendent de facteurs techniques (GNL ou gazoduc), économiques (rentabilité) et géopolitiques (tensions régionales).
En 2021, l’UE importait environ 83 % de son gaz naturel, soit 320,6 milliards de mètres cubes.
En 2023, malgré une baisse de la consommation liée aux efforts d’efficacité énergétique, les importations restaient cruciales, avec une part accrue du GNL (59 % des importations françaises, par exemple). La Russie, qui fournissait directement jusqu’à 45 % du gaz européen en 2021, ne représente plus que 18% aujourd’hui. Une partie de l’énergie fossile russe passe par des pays tiers tels que l’Inde et la Chine avant d’être exportée vers l’Union Européenne. Belle hypocrisie.
Les États-Unis ont comblé ce vide, livrant plus de 50 Gm³ de GNL à l’UE en 2022, mais ce gaz, plus coûteux à produire et transporter, pèse sur les finances européennes face à une concurrence asiatique croissante pour ces volumes.
Estimation des volumes importables depuis la Méditerranée orientale
Les champs gaziers de la Méditerranée orientale pourraient fournir une partie significative du gaz européen, bien que leur capacité à remplacer totalement les importations actuelles soit limitée.
Voici une estimation basée sur les réserves prouvées et les projets en cours :
Champ Zohr (Égypte) : Découvert en 2015 par Eni, ce gisement géant contient environ 850 Gm³ de gaz récupérable. Avec une production annuelle de 30 Gm³ atteignable grâce à sa mise en service rapide (fin 2017), l’Égypte utilise une large part pour son marché intérieur. Cependant, via ses terminaux GNL d’Idku (capacité de 7,2 Gm³/an) et de Damiette (6 Gm³/an), elle pourrait exporter jusqu’à 10-12 Gm³/an vers l’Europe à court terme, surtout si la demande domestique est stabilisée.
Champs Leviathan et Tamar (Israël) : Leviathan (623 Gm³) et Tamar (283 Gm³), exploités par Noble Energy (Chevron) et ses partenaires, totalisent plus de 900 Gm³ de réserves. Israël produit environ 20 Gm³/an, dont une partie est exportée vers l’Égypte (64 Gm³ sur 10 ans, soit 6,4 Gm³/an). Si le projet de gazoduc EastMed (1 900 km jusqu’en Italie) voit le jour d’ici 2027, il pourrait acheminer 10 Gm³/an vers l’Europe. À défaut, le GNL via l’Égypte reste une option, ajoutant potentiellement 5-7 Gm³/an.
Champ Aphrodite (Chypre) : Découvert en 2011 par Noble Energy, il contient environ 129 Gm³. Faute de demande locale suffisante, Chypre envisage un gazoduc vers l’Égypte pour conversion en GNL, avec un potentiel d’exportation de 4-5 Gm³/an vers l’Europe d’ici la fin de la décennie, les tensions avec la Turquie doivent s’apaiser.
Total estimé : À moyen terme (5-10 ans), l’Europe pourrait importer entre 19 et 24 Gm³/an depuis ces champs, soit environ 6-8 % de ses besoins actuels. Le GNL dominera à court terme via les terminaux égyptiens, mais le gazoduc EastMed, malgré son coût (6-7 milliards d’euros) et ses défis géopolitiques, offrirait une alternative à plus long terme.
GNL ou gazoduc : quel avenir ?
Le GNL offre une flexibilité immédiate, mais son coût énergétique (liquéfaction, transport, regazéification) le rend 2,5 fois plus émissif que le gazoduc. Les terminaux européens (France, Espagne, Italie) sont bien équipés pour absorber ces volumes, mais la concurrence avec l’Asie, où la demande croît (9,6 %/an en Chine), risque de faire grimper les prix. Le gazoduc EastMed, soutenu par l’UE comme projet d’intérêt commun, promet une solution plus stable, mais sa faisabilité reste incertaine face aux rivalités régionales (Turquie, Chypre) et à la priorité donnée au GNL mondial.
Une Europe tiraillée
L’avenir énergétique européen oscille entre pragmatisme et ambition. Les États-Unis, avec leur gaz de schiste, offrent une sécurité immédiate, mais à un coût économique élevé. L’Asie, en pleine expansion énergétique, menace cette stabilité en captant des volumes croissants de GNL. La Méditerranée orientale, bien que prometteuse, ne suffira pas seule à combler le vide russe : ses 20-25 Gm³/an potentiels restent modestes face aux 320 Gm³ importés annuellement.
A moins d’un miracle, tant que l’UE refusera de revenir sur les textes votés tels que le Green Deal et le Net Zero, et s’empêchera d’exploiter le gaz de schiste présent dans son sous-sol, elle restera dépendante des importations en gaz d’autant que le nucléaire ne figure pas en tête de liste des énergies à utiliser.
La France restera donc impactée négativement par ces décisions alors qu’elle a des atouts majeurs d’une électricité abondante et peu chère à produire grâce à son parc nucléaire et au potentiel gaz de schiste non exploité (réserves estimées à près de 3 900 Gm³).
Donald Duck